Peter TSCHERKASSKY
-
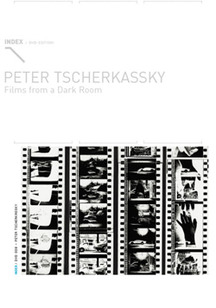 FILMS FROM A DARK ROOM - PETER TSCHERKASSKY - DVD (TW7851)
FILMS FROM A DARK ROOM - PETER TSCHERKASSKY - DVD (TW7851)
Entre 1977 et 1979, encore étudiant en journalisme et en sciences politiques, Peter Tscherkassky (1958) commence à s’intéresser au cinéma expérimental et d’avant-garde via une série de cinq conférences-marathons (à chaque fois, cinq ou six heures de projection de films, suivies de deux heures d’exposé) que P. Adams Sitney, un des « pèlerins-prophètes » de ce pan du septième art, donne au Musée du cinéma de Vienne. À la fin de ce processus d’initiation, le jeune étudiant autrichien achète sa première caméra Super 8. Au cours des quatre années suivantes, il produit en respectant ce format de pellicule – ou en choisissant d’en « gonfler » la copie en 16 mm en bout de course – une bonne douzaine de films. Mais, c’est à partir du milieu des années 1980 et de ses premiers courts métrages directement conçus en 16 mm ou 35 mm que sa production cinématographique semble vraiment trouver une voie singulière. Les œuvres que Peter Tscherkassky commence alors à projeter hors des frontières du monde germanique, à un public souvent éberlué, sont des films de found footage – c’est-à-dire d’images trouvées, empruntées (ou volées) à autrui, pour se voir recyclées, retravaillées, remontées, réappropriées et investies d’une seconde vie. Un jeu de recréation de formes nouvelles à partir de matériaux anciens qui traduit un amour profond – mais non tétanisé par le respect, les convenances et le droit de préséance – pour l’histoire du cinéma et pour la pellicule qui, jusqu’à cette époque en tout cas, lui a donné l’essentiel de sa matérialité.
Pour Motion Picture [La Sortie des ouvriers de l’usine Lumière à Lyon] (1984), Tscherkassky aligne côte à côte, en chambre noire, cinquante bandes de pellicule non exposée avant d’en sensibiliser l’émulsion en y projetant une image, un seul photogramme, de la célèbre « vue » tournée par les frères Lumière devant leur usine en 1895. Les cinquante bandes sont ensuite montées séquentiellement, dans le sens « de lecture », de gauche à droite. Une fois projeté, le nouveau film redonne vie et mouvement à une image figée, tout en faisant basculer sa valeur de témoignage, d’ordre documentaire, du côté de l’abstraction et d’une chorégraphie non contrôlée de taches d’ombre et de lumière.
Une douzaine d’années plus tard, toujours sous influence de la fratrie d’industriels lyonnais et du cinéma dit « des premiers temps » – mais aussi de l’histoire de la Mittel Europa revue par le cinéma glamour des années 1960 – Tscherkassky retravaille pour son très court métrage L’Arrivée (1997-1999, 2’) une scène d’_Arrivée du train en gare de_… tirée de Mayerling de Terence Young (1968). Pour clarifier le clin d’œil au film originel tourné à La Ciotat en 1895, et faire rentrer le train dans le plan du bon côté du cadre, Tscherkassky inverse – gauche/droite – le plan volé au mélodrame romanesque de 1968. Partant d’un écran blanc et de l’incursion dans l’image de traces de la matérialité de la pellicule (perforations, rayures, poussières) et combinant tendance à l’abstraction et derniers vestiges d’un fragile fil narratif, il accélère et sature les éclats d’images et de sons détournés vers un préfinal paroxystique en forme de collision et de déraillement… Puis, d’une fin quelque peu apaisée, marquée par le baiser que se donnent Catherine Deneuve et Omar Sharif. La « manufracture » de ce prototype (le jeu de mots est du cinéaste lui-même et on y retrouve à la fois le côté manuel de la fabrication de son cinéma et le côté haché et fragmenté du résultat) préfigure ses deux films à venir.
À la même époque, l’artisan autrichien achète pour cinquante dollars une copie de seconde main de The Entity [L’Emprise] de Sidney J. Furie (1981). Dans ce film d’horreur américain assez classique, une mère de famille célibataire (interprétée par Barbara Hershey) est harcelée, dans son pavillon suburbain, par un ennemi invisible et pervers. Sur fond de musique souvent grandiloquente et surdramatisante, le scénario utilise deux recettes désormais habituelles du film d’épouvante : d’une part, l’attente et l’imprévisibilité du danger et, d’autre part, le doute quant au caractère réel ou fantasmé de la menace. Malgré sa fin ouverte, les deux tiers du film sont bien dévolus à une tentative d’explication, de rationalisation de l’irrationnel par de multiples personnages de chercheurs universitaires. À partir de ce corpus de base, Tscherkassky recrée en laboratoire – comme le baron Frankenstein de Mary Shelley – deux nouvelles créatures : Outer-Space (1999) et Dreamwork (2001), les deuxième et troisième volets de sa Cinemascope Trilogy. Sous la lumière rouge de sa chambre noire, il sensibilise sa pellicule vierge à l’aide d’un crayon laser jouet et de bouts de photogrammes et de fragments de bande-son du film de Furie. Le long métrage se raccourcit, le film passe de la couleur au noir et blanc mais, surtout, le fil narratif s’effiloche et les images se mettent à vibrer (en écho aux miroirs tremblants, tout petits germes d’expérimentation visuelle déjà présents dans le film d’origine). Le corps de l’actrice se dédouble, flotte, déborde de son enveloppe. Les repères s’estompent et le film file comme un train fou vers un crescendo chaotique de bruit blanc et de clignotement d’images solarisées. Comme si la présence invisible et menaçante de l’entité maléfique déréglait le dispositif même de l’enregistrement de sa présence. Le cinéma peut-il rester sage, normatif et rationnel pour filmer l’irrationnel ? Alors que soixante ans plus tôt, dans trois films expérimentaux pour l’époque, Jacques Tourneur apprenait à nous faire peur par le chuchotement, l’absence et le dépouillement, Peter Tscherkassky atteint le même genre de trouble par la saturation, l’accumulation et le déferlement (des sons et des images).
(Philippe Delvosalle)