Stephen DWOSKIN
-
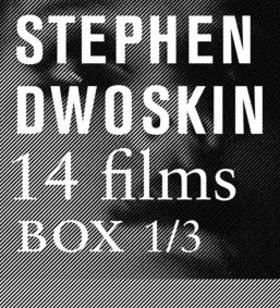 DWOSKIN - COFFRET#1 - DVD#1 (STEPHEN) (TW1751)
DWOSKIN - COFFRET#1 - DVD#1 (STEPHEN) (TW1751)
« Si vous effleurez le bois avec le doigt, vous sentez le bois ; si une écharde vous blesse, vous allez sentir votre doigt. C’est ainsi que fonctionne la douleur. » (Stephen Dwoskin, dans Pain Is, 1997)
« C’est pas simple de décrire une chaîne… Ce qui est dur en fin de compte, c’est d’avoir un métier dans les mains. Moi je vois, je suis ajusteur, j’ai fait trois ans d’ajustage, pendant trois ans j’ai été premier à l'école… Et puis, qu’est-ce que j’en ai fait ? Au bout de cinq ans, je ne sais plus me servir de mes mains, j’ai mal aux mains. J’ai un doigt, le gros, j’ai du mal à le bouger, j’ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t’as envie de pleurer dans ces cas-là. Ils ont bouffé tes mains. J’ai envie de faire un tas de choses et puis, je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine m’en servir. C’est tout ça, tu comprends. T’as du mal à écrire. J’ai du mal à écrire, j’ai de plus en plus de mal à m’exprimer. Ça aussi, c’est la chaîne… » (Christian Corouge, dans Avec le sang des autres du Groupe Medvedkine de Sochaux, 1974)
Il pourra paraître osé à certains, qui connaissent à la fois le cinéma de Stephen Dwoskin et celui des Groupes Medvedkine, de mettre ces deux citations en parallèle. Qu’y a-t-il de commun entre un ancien étudiant en design devenu peintre et cinéaste underground professionnel et un ouvrier spécialisé d’une usine Peugeot, cinéaste du soir et du week-end (comprenez : en dehors de ses harassantes journées de travail à la chaîne) ? D’abord, il y a leurs corps meurtris, leurs handicaps. Conséquences de la poliomyélite, maladie virale paralysante, contractée à l’âge de sept ans par Stephen Dwoskin (né en 1939 à Brooklyn, New York) et de conditions de travail inhumaines subies vers l’âge de vingt ans pour Christian Corouge (né vers 1950, sans doute quelque part dans l’Est de la France). Un corps amoindri qui se voit confronté à des obstacles à une vie sociale facile ou insouciante pour le premier ; une position sociale défavorable (une condition de classe) qui pousse à un travail qui abîme le corps pour le second. Puis, même si à partir de là pas mal de choses diffèrent (en 1974, Corouge dit sa douleur à ne plus pouvoir caresser sa femme avec ses mains bousillées tandis qu’on exagèrerait à peine en affirmant que, dès ses premiers films du début des années 1960, Dwoskin n’a fait que caresser des femmes, de ses mains, sans doute, et, clairement, de sa caméra), il y a surtout une idée très forte qui les rassemble : se réapproprier leur image à l’écran. En avril 1968, Chris Marker vient montrer aux ouvriers de la Rhodiacéta de Besançon le film À bientôt j’espère qu’il a tourné, treize mois auparavant, lors de leur grande grève de 1967. Malgré la sensibilité de gauche du cinéaste et sa sympathie pour leur cause, les ouvriers ne se reconnaissent pas dans son film. Chahuté par ces remises en questions, Marker pousse les ouvriers à réaliser leurs propres films, à reprendre le contrôle de leur propre discours. Conséquent dans l’enchaînement de ses paroles et de ses actes, le réalisateur se déplacera régulièrement à Besançon et à Sochaux, en compagnie de camarades techniciens (preneurs de son, monteuses, etc.), pour donner des cours de cinéma aux ouvriers et permettre l’éclosion des Groupes Medvedkine. Je ne sais pas vraiment comment, quelques années auparavant et dans un tout autre contexte culturel, politique et économique (celui des avant-gardes new-yorkaise et, dès 1964, londonienne du cinéma), Stephen Dwoskin en était arrivé à un parti pris du même ordre mais la démarche qui s’en suit est en tout cas très proche : ne compter sur personne d’autre que soi-même – aussi bien intentionné que puisse être l’éventuel porte-parole qui offrirait ses services – pour filmer ses propres émotions, joies, plaisirs, rêves, déconvenues et blessures.
Toute l’œuvre de Stephen Dwoskin tourne autour (parfois au sens littéral) du corps – et de son corollaire immédiat, dès qu’il est question de la présence du corps au cinéma : le regard. Ou plutôt, les corps et les regards – au pluriel. Il y a d’abord le corps de Stephen Dwoskin lui-même – évidemment inséparable de ses béquilles, orthèses cruro-jambières ou chaise roulante – qui ne semble apparaître durablement à l’image dans un de ses films qu’au bout de presque quinze ans d’exercice intense du cinéma, dans son dix-huitième opus : Behindert (le titre est clair ; en français : Handicapé) tourné à Munich et Londres en 1973 et 1974. De leur rencontre (un repas chez des amis où le cinéaste n’a d’yeux que pour elle) à leur séparation (la femme s’éloigne sur le trottoir d’en face), en passant par l’excitation des débuts et l’apparition progressive des difficultés et des doutes, ce faux documentaire remet en scène les relations entre Dwoskin et l’actrice de théâtre et danseuse allemande Carola Regnier. Le film est cru, sans complaisance bien-pensante. Quand Carola déshabille Stephen en défaisant les lanières de l’exosquelette qui maintient ces jambes qui, depuis longtemps, n’arrivent plus à le porter, le regard de la femme en dit long : triste, compassé et décomposé, au bord des larmes. Plus tard, en mots cette fois-ci, au cours d’une dispute, elle n’arrive même plus à taire le sentiment que « tout est difficile » et que le handicap de Stephen « leur gâche la vie ». En 1981, dans Outside In, Dwoskin traite, comme presque toujours dans son œuvre, quasiment du même sujet mais selon un traitement légèrement différent. D’une seule femme et d’une seule période de sa vie, on passe à une approche plus diachronique et plus éclatée, à plusieurs muses (Olimpia Carlisi, Béatrice Cordua, etc.). Mais, surtout, on passe d’un film triste à une quasi-comédie qui flirte régulièrement avec le burlesque (on sait que les chutes et les problèmes de verticalité de personnages vacillants au bord du vide sont une des figures-clés de ce cinéma de la fragilité de l’homme). Une femme nue essaie les orthèses et les béquilles du cinéaste tandis qu’un peu plus tard, comme en écho à cette scène, une autre enfile avec lenteur et méticulosité les pièces de cuir (ou de latex) de sa combinaison bondage. Un goût pour les rituels érotiques qu’on retrouvait déjà – mais de manière plus singulière et personnelle, moins liée à des imageries collectivement répandues – dans les courts métrages des années 1960 et du début des années 1970. Dans Take Me (1968), une jeune femme en peignoir molletonné (Clodagh Brown) chantonne et fait des allers-retours, du bord gauche du cadre au bord droit. Un rapport de séduction est perceptible ; la fille est aguicheuse mais sans en rajouter. Trois échelles de plans (plan américain / plan de taille / gros plan) se succèdent. La mélopée (mise en musique comme souvent dans les films de Dwoskin par Gavin Bryars) se teinte de plus en plus d’écho et part en vrille. La fille se déshabille, embrasse la caméra. Son maquillage déborde et contamine petit à petit tout son corps. Entre peintures tribales et camouflage de GI, entre performance actionniste viennoise et films plus tardifs de Mara Mattuschka (une approche plus typographique d’un body painting tirant vers le body printing), sa peau blanche est bientôt entièrement peinturlurée de noir. La caméra caressante, maniée comme toujours par Dwoskin lui-même, cadre des gros plans qui touchent à l’abstraction. Les bouts de corps ne sont pas toujours identifiables. Et au milieu de cette chorégraphie sensuelle en clair-obscur pointent régulièrement deux yeux très blancs qui, sans ambages, fixent l’axe de la caméra et interrogent le voyeurisme du cinéaste et du spectateur – et l’attitude, entre abandon et prise de contrôle, de celle qui s’y expose. Une omniprésence du regard qu’on retrouve dans Girl (1975), mais selon un dispositif assez différent. Linda Marlowe y est nue dès le début, contre un mur, dans l’embrasure d’une fenêtre occultée par un rideau noir, les pieds sur un tapis rouge, comme un modèle de nu pour un peintre. Le plan se poursuit (il durera tout le film, c’est-à-dire 22’), le temps s’écoule lentement. Au début, il y a chez la fille comme une gêne, un malaise, presque des tics. Elle baisse la tête ou joue nerveusement avec ses doigts. Mais, au fur et à mesure que le temps passe et que le plan dure, on la voit parler (on ne peut pas l’entendre : le film est musical mais sans dialogues), communiquer avec Dwoskin derrière la caméra, sourire, voire carrément rigoler. Ces deux courts métrages (comme pas mal d’autres de la même période) rendent très clair le fait que dans ces films d’avant Behindert et d’avant l’apparition à l’image du corps de Dwoskin celui-ci était déjà très présent hors champ, derrière la caméra et – en pensées, en sensualité et en complicité – très près de la peau de ces femmes (et qu’objectivement il se trouve à 20 cm de l’une et à 5 m de l’autre, n’a ici que peu d’importance). En filmant, selon différents dispositifs et rituels, le corps nu de ces très belles femmes dont leurs visages (« Le visage c’est le centre de l’émotion pour moi. L’idée d’un visage auquel réagir. Un miroir à partir duquel les gens peuvent répondre et insérer subjectivement et émotionnellement ce qu’ils veulent », Dwoskin dans Trying to Kiss the Moon), le cinéaste parle aussi, en creux, de son corps à lui et de la relation de désir qui les lie.
Entre films expérimentaux assez clairement inspirés par ceux d’Andy Warhol ou de Jack Smith et « journal filmé » à la Jonas Mekas, entre films sur l’art, captations de spectacles, adaptations littéraires, films-essais sur la douleur ou la maladie et échange de lettres-vidéo avec Robert Kramer, Stephen Dwoskin multiplie les formes et les prétextes mais ne perd jamais le fil global de son œuvre. Une intensité qui traverse tous ses films depuis 1961, les imbrique les uns dans les autres et transforme chacun d’entre eux en une pièce d’un grand tout qui palpite de l’énergie folle de la nécessité. Ce que la cinéaste Cathy Day, dans un texte pour le livret du coffret de six DVD parus en 2006 aux Éditions du Renard, exprime dans les trois équations de Stephen Dwoskin : « Je filme donc je suis » / « Je te filme donc tu es » / « Je filme donc nous sommes ». Ou ce que dans Trying to Kiss the Moon (1994), sorte de film-bilan qui incorpore à la fois des images poignantes de lui enfant (encore valide) et adolescent (déjà handicapé) tournées par son père et des extraits de pas mal de ses propres œuvres, Dwoskin exprime lui-même ainsi : « Le travail c’est comme un ami. Sans le travail, je me sens comme perdu. Mon travail est centré sur les gens. C’est une manière aussi de capturer ou d’embrasser quelque chose qui me manquait, une manière aussi de trouver un moyen de dialoguer avec d’autres. »
Philippe Delvosalle